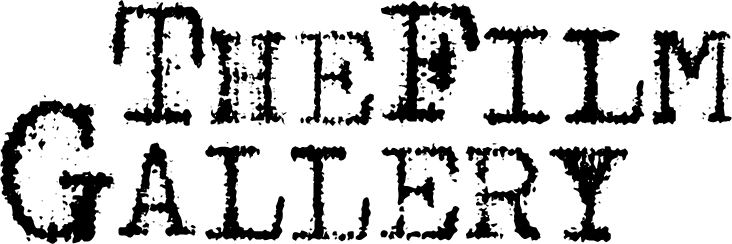Group Show
As Spin Says
June 15th - July 29th, 2023
As Spin Says
exposition collective
15 juin – 29 juillet
avec :
Distruktur, Rosa Joly, Nathaniel Draper, François Delagnes, Hector Castells Matutano
Vernissage le jeudi 15 juin à 18h
43 rue du Fb Saint-Martin Paris 10
As Spin Says
Miles Davis is quoted as saying that in jazz, it’s “not the notes you play, it’s the notes you don’t play”. In other words, as I understand it, jazz is an artform that constantly plays on our expectations, evoking with every note actually played the multiple other notes that could have been and the infinite directions each piece could take, in an incessant tightrope walk between that which is and that which could have been, each presence gaining in consistency by the various absences that it implies. In film theory, the thickness and depth conferred to the image by the absences that it contains – whether through the representation of fleeting moments that no longer exist in reality, or through the centrifugal nature of the film screen, pushing the spectator to consider the offscreen in their apprehension of the image presented – has become almost a cliché. And yet, in each of the works shown in As Spin Says at The Film Gallery, this particularly jazzy relationship to absence is individually and collectively explored anew. More specifically, the five works in the exhibition, as well as the eponymous poem that accompanies it, have in common a desire to seek out these absences, make them manifest, material, tangible.
There seem to be three separate sections to As Spin Says. The first is made up of the association of two works that the public is greeted with when they walk into the gallery. Night Tide by Rosa Joly (2019-2023) and New Blues by Hector Castells Matutano (2023) both participate in the repurposing of filmic materials (film stock for New Blues, cyanotype on glass for Night Tide) to construct enigmatic sculptures. Joly’s Night Tide, which consists of cyanotype abstract images applied to glass panels that can be arranged in various configurations, with small recognizable shapes – such as silhouettes of face masks – spray painted in various spaces on the panels, is set up in front of the main window of the gallery. This means that as you arrive, even before setting foot in the gallery, you are confronted with a work that invites us to contemplate the idea of masks and masking, of that which you are allowed to see and that which is purposefully obscured from view. The rearrangeable nature of the pink and blue panels also invites comparison with jazz performance, evoking infinite directions that the work can be presented and re-presented. In a peculiar way, then, the work seems to reflect on, and present in static yet playful form, the nature of film as the arrangement of forms in such a way as to both make visible and obscure light. Similarly, Matutano’s work, a series of 120mm and 35mm filmstrips arranged in a light box, first strikes us as a reminder that film serves essentially to mask and modulate light. While this is again a static work, the colourful forms – some purely geometric, some more organic – that are printed on the filmstrips, and especially the interplay between the differing patterns on each filmstrip that are placed side by side, inevitably produce movement in the imagination of the spectator. There is an improvisational quality to the work, which was indeed inspired by Miles Davis’ last concert in Paris (New Blues, 1991), a throwing together of colours, shapes and timbres that seem to want to conjure up a free jazz piece in the mind’s ear of the viewer.
Together, the two works create an airy, jazzlike atmosphere, where the various colours, materials and slight modulations of the light conjure up multiple possibilities, inviting the public to fill in the blanks, to imagine what various forms the works could have taken, or could still take. The last two works of the gallery, Postcard1 by Nathaniel Draper (2023) and North South East West by François Delagnes (2023) are much earthier, more concrete, both in different ways interrogating the material presence of historical violence. In Draper’s work, the characters in various classic Westerns are digitally removed from the desert landscapes that they were situated in. We are thus presented with a series of vast landscapes, the striking colours of which seem all the more unreal and eerie in the absence of humans. There is a certain ambiguity here, as the removal of the colonialist characters seems at once to invite the spectator to imagine other possible, perhaps less violent, histories for these lands, and yet the artificiality of the image does not allow us to naively believe in some pristine ahistorical utopia. The removals are never entirely seamless, leaving shadows, glitches and visual wobbles in the frame, as though even the postcard versions of these landscapes still carry the scars of the human violence that has taken place there. Delagnes’ piece is also interested in the scars that violence leaves on the landscape, as he has collected what look like benign beachfront rocks, edges smoothed and rounded from the movement of the ocean. Quickly, however, you realize that these are not rocks, so much as parts of brick walls from houses in Le Havre that were demolished during the Second World War. These pieces of homes were thrown into the ocean, only to then wash back up onto the shore many years later, strange, stony reminders of the extreme destruction that took place on those shores just a few decades beforehand. Delagnes presents these found objects as if they were sculptures, some of them on turning on spinning platforms, imbuing them with a certain reverence, as if to restore to them a certain memorial status. They are accompanied by large photographs, from the same region, which show an area in all possible directions at once. The artist chooses his spot, and exposes the film four times, each time facing in each of the cardinal directions. The final product thus shows all four points of view at once, showing all possible viewpoints in the same frame and therefore paradoxically obscuring more that it reveals. Perhaps more importantly, the photograph makes evident that the real subject of the work is that which is not represented: the artist himself, his body, situated in the space he is photographing. He situates the various perspectives, links them to his particular position in space, anchors them and therefore gives them consistency together. And yet, he is exactly what is absent from the final image.
This is what links the two sections the materialization of the absence at the heart of the image, that constitutive absence that allows us to imagine all possible directions we could have gone, whether it be in any one moment or event, as in the first two works, or in the long term, the grounded Histories that leave their mark, as in the last two. And this is why, I think, the work by Distruktur, Rodagem/Tournage (2018-2023) takes its place in the centre of the exhibition, as it serves as a link between these two conceptions of the experience of multi-directional absence. Two films, made from the same source material, are shown one on top of the other. Two differing perspectives on one same roadtrip through Brazil, filming various locations, some historically charged, some vast and empty. But also filming people, some known to the filmmakers, some strangers that are encountered along the way. What better context to explore the search for a constitutive absence, or the constant possibility of various directions in which one can go, than a roadtrip, where we move constantly foreward, looking towards new possibilities, and leaving the roads not taken behind us. A fleeting event, but one that is constantly brought into focus by the histories that are encountered along the way. In presenting the roadtrip as a diptych on loop, the two contrasting perspectives are juxtaposed in such a way that it is the differences, the interstices between the two experiences of the same event that are foregrounded, reminding us once again that it is the constitutive absence that gives substance to that which can be seen. Cora Camoin writes in As Spin Says : “I just want to forget last night / I can try to spin it every which way I like”. Every which way is spun in these works, but there is no forgetting. On the contrary, in spinning we remember that which was absent.
Charlie Hewison
July,2023
As Spin Says
Miles Davis est cité comme ayant dit que dans le jazz, ce ne sont "pas les notes qu'on joue, mais les notes qu'on ne joue pas". En d'autres termes, de ce que je’comprends, le jazz joue constamment avec nos attentes, évoquant avec chaque note réellement jouée les multiples autres notes qui auraient pu l'être et les directions infinies que chaque morceau aurait pu prendre, dans une marche incessante sur le fil entre ce qui est et ce qui aurait pu être, chaque présence gagnant en consistance par les diverses absences qu'elle implique. En théorie du film, l'épaisseur et la profondeur conférées à l'image par les absences qu'elle contient - que ce soit par la représentation de moments fugaces qui n'existent plus dans la réalité ou par la nature centrifuge de l'écran de cinéma, poussant le spectateur à considérer ce qui se trouve hors champ dans sa compréhension de l'image présentée - sont devenues presque un cliché. Et pourtant, dans chacune des œuvres présentées dans As Spin Says à The Film Gallery, cette relation particulièrement jazzy à l'absence est explorée à nouveau, individuellement et collectivement. Plus précisément, les cinq œuvres de l'exposition, ainsi que le poème éponyme qui l'accompagne, ont en commun le désir de chercher ces absences, de les rendre manifestes, matérielles, tangibles.
Il semble y avoir trois sections distinctes dans As Spin Says. La première est constituée de l'association de deux œuvres accueillant le public lorsqu'il entre dans la galerie. Night Tide de Rosa Joly (2019-2023) et New Blues d'Hector Castells Matutano (2023) participent toutes deux à la réappropriation de matériaux cinématographiques (pellicule de film pour New Blues, cyanotype sur verre pour Night Tide) pour construire des sculptures énigmatiques. Night Tide de Joly, qui se compose d'images abstraites cyanotype appliquées sur des panneaux de verre pouvant être disposés de différentes manières, avec de petites formes reconnaissables - telles que des silhouettes de masques faciaux - bombées sur divers espaces sur les panneaux, est installée dans la vitrine de la galerie. Cela signifie qu'en arrivant, avant même de mettre un pied dans la galerie, vous êtes confronté à une œuvre qui nous invite à contempler l'idée de masques et de caches, de ce que l'on vous autorise à voir et de ce qui est délibérément dissimulé à la vue. La nature réarrangeable des panneaux roses et bleus invite également à la comparaison avec la performance jazz, évoquant les directions infinies dans lesquelles l'œuvre peut être présentée et représentée à nouveau. D'une manière particulière, l'œuvre semble ainsi réfléchir et présenter sous une forme statique mais ludique, la nature du film en tant qu'agencement de formes de manière à la fois à cacher et à rendre visible la lumière. De même, l'œuvre de Matutano, une série de bandes de film 120 mm et 35 mm disposées dans une boîte lumineuse, nous frappe d'abord comme un rappel que le film sert essentiellement à masquer et à moduler la lumière. Bien que ce soit à nouveau une œuvre statique, les formes colorées - certaines purement géométriques, d'autres plus organiques - imprimées sur les bandes de film, et surtout l'interaction entre les motifs différents sur chaque bande de film placée côte à côte, produisent inévitablement un mouvement dans l'imagination du spectateur. Il y a une qualité d'improvisation dans l'œuvre, qui a en effet été inspirée par le dernier concert de Miles Davis à Paris (New Blues, 1991), un mélange de couleurs, de formes et de timbres qui semble vouloir conjurer un morceau de free jazz dans l'oreille de l'observateur.
Ensemble, les deux œuvres créent une atmosphère aérienne et jazzy, où les différentes couleurs, matériaux et légères modulations de la lumière évoquent de multiples possibilités, invitant le public à combler les vides, à imaginer les différentes formes que les œuvres auraient pu prendre, ou pourraient encore prendre. Les deux dernières œuvres découvertes dans l’exposition, Postcard1 de Nathaniel Draper (2023) et North South East West de François Delagnes (2023), sont beaucoup plus terre-à-terre, plus concrètes, interrogeant toutes deux, de différentes manières, la présence matérielle de la violence historique. Dans l'œuvre de Draper, les personnages de divers westerns classiques sont supprimés numériquement des paysages désertiques dans lesquels ils étaient situés. Nous sommes ainsi confrontés à une série de vastes paysages, dont les couleurs frappantes semblent d'autant plus irréelles et inquiétantes en l'absence d'êtres humains. Il y a une certaine ambiguïté ici, car la suppression des personnages colonialistes semble à la fois inviter le spectateur à imaginer d'autres histoires possibles, peut-être moins violentes, pour ces terres, et pourtant l'artificialité de l'image ne nous permet pas de croire naïvement en quelque utopie ahistorique. Les suppressions ne sont jamais complètement fluides, elles laissent des ombres, des glitchs et des tremblements visuels dans le cadre, comme si même dans leur version carte postale, ces paysages portaient encore les cicatrices de la violence humaine qui s'y est déroulée. L'œuvre de Delagnes s'intéresse également aux cicatrices que la violence laisse sur le paysage, car il a collecté ce qui ressemble à des rochers inoffensifs en bord de mer, dont les bords sont lissés et arrondis par le mouvement de l'océan. Rapidement, cependant, on se rend compte que ce ne sont pas des rochers, mais plutôt des morceaux de murs en briques de maisons du Havre qui ont été démolies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces morceaux de maisons ont été jetés dans l'océan, pour ensuite être rejetés sur le rivage bien des années plus tard, étranges rappels pierreux de la destruction extrême qui a eu lieu sur ces rives quelques décennies auparavant. Delagnes présente ces objets trouvés comme s'ils étaient des sculptures, certains d'entre eux tournant sur des plateformes rotatives motorisée, leur conférant une certaine vénération, comme pour leur redonner un certain statut mémorial. Ils sont accompagnés de grandes photographies, de la même région, qui montrent une vue dans toutes les directions possibles à la fois. L'artiste choisit son emplacement et expose le film quatre fois, chaque fois en regardant dans chacune des directions cardinales. Le produit final montre ainsi les quatre points de vue à la fois, présentant tous les perspectives possibles dans le même cadre, la saturation de formes obscurant paradoxalement plus qu'il n'en révèle. Plus important encore, la photographie met en évidence ce qui n'est pas représenté : l'artiste lui-même, son corps, placé dans l'espace qu'il photographie. Il situe les différentes perspectives, les relie à sa position particulière dans l'espace, les ancre et leur donne ainsi une cohérence d’ensemble. Et pourtant, il est exactement ce qui est absent de l'image finale.
C'est ce qui relie les deux sections : la matérialisation de l'absence au cœur de l'image, cette absence constitutive qui nous permet d'imaginer toutes les directions possibles que nous aurions pu prendre. Que ce soit a partir du moment donné, de l’événement - dans les deux premières œuvres de l’exposition - ou du long terme, des Histoires enracinées qui laissent leur marque - dans les deux dernières. Et c'est pourquoi, je pense, l'œuvre de Distruktur, Rodagem/Tournage (2018-2023), occupe une place centrale dans l'exposition, car elle sert de lien entre ces deux conceptions de l'expérience de l'absence multidirectionnelle. Deux films, réalisés à partir du même matériel source, sont présentés l'un au-dessus de l'autre. Deux perspectives différentes d'un même road trip à travers le Brésil, filmant divers lieux, certains chargés d'histoire, d'autres vastes et apparemment vides. Mais aussi des personnes filmées, certaines connues des cinéastes, d'autres des étrangers rencontrés en chemin. Quel meilleur contexte pour explorer la recherche d'une absence constitutive, ou la possibilité constante de différentes directions dans lesquelles on peut aller, que lors d'un road trip, où l'on avance constamment, cherchant de nouvelles possibilités, et laissant derrière nous les routes non empruntées. Un événement éphémère, mais constamment approfondi par les Histoires rencontrées en chemin. En présentant le road trip comme un diptyque en boucle, les deux perspectives contrastées sont juxtaposées de manière à mettre en évidence les différences, les interstices entre les deux expériences du même événement, nous rappelant une fois de plus que c'est l'absence constitutive qui donne substance à ce qui peut être vu. Cora Camoin écrit dans As Spin Says : "Je veux juste oublier la nuit dernière / Je peux essayer de la tourner dans tous les sens que je veux". Ces œuvres sont tournées dans tous les sens possibles, mais il n'y a pas d'oubli. Au contraire, en tournoyant, nous nous souvenons de ce qui était absent.
Charlie Hewison, juillet 2023